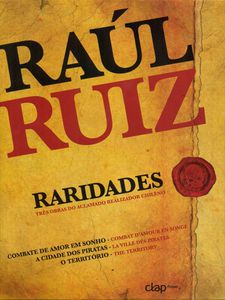Cinéma documentaire de Naomi Kawase
De "Ma seule famille" (1989) à "Trace" (2012)
La récente rétrospective à la Cinémathèque (17 octobre-12 novembre 2012) consacrée à la cinéaste japonaise Naomi Kawase a permis de jeter une lumière particulière sur la relation qu'elle entretenait avec sa grand-mère. En un seul week-end (10 et 11 novembre), il a été ainsi permis de voir toute une série de films, de durées variables (10 à 45 minutes), révélateurs de l'attention soutenue portée par Naomi Kawase à Uno, sa grand-mère adoptive.
Les premiers court-métrages, s'ils marquent, dès "Ma seule famille" (tourné dans le cadre de ses études) cette insistance, ne révèlent pas grand-chose quand au dévoilement d'un personnage singulier. Que ce soit dans "Escargot" (1994), "Regardez le ciel" (1995), "Le soleil couchant" (1996), les films ont beau s'allonger, l'approche, pour le moins ténue, ne dévie pas : Naomi Kawase filme sa grand-mère dans son quotidien, mais sans que cette saisie s'ouvre sur une autre dimension qu'une simple immédiateté.
A côté de ce qui ressemble souvent à un brouillon filmique, proche de films de vacances, il y a de quoi s'étonner que cette exploration - sincère par cette volonté de mettre l'accent sur un parent important -, ne produise aucune information particulière. On aurait en effet aimé en savoir plus sur cette grand-mère, mais il est rare que Kawase, dans ses premiers films, lui pose une question frontale sur ses origines, les raisons pour lesquelles elle a été amenée à l'élever.
C'est ainsi que d'un documentaire à l'autre, au lieu de creuser du sens, c'est à une forme d'opacité à laquelle le spectateur est renvoyé. Les séquences répétitives y abondent, comme si une séquence dressée dans un film devait être réitérée dans un autre, comme pour y marquer une suture cinématographique. Mais le plus gênant, dans ces documentaires, c'est l'insistance confinant au malaise avec laquelle Kawase braque sa caméra sur sa grand-mère, en tout temps, notamment dans le froid de l'hiver, ne prenant pas en compte ses demandes de rentrer parce qu'elle a froid.

Avec "Naissance et maternité", tourné en 2006, le changement est radical. Naomi Kawase est une cinéaste internationalement reconnue, depuis notamment le prix remporté à Cannes pour son premier long-métrage "Suzaku". Son travail fictif ne se séparant plus de son œuvre documentaire, "Naissance et maternité" révèle un regard autrement plus aiguisé que ses documentaires de jeunesse. Pour autant, la figure centrale du film reste paradoxalement la grand-mère, alors que le titre du film est supposer braquer le regard sur la naissance de l'enfant de Naomi Kawase. L'ouverture du film est stupéfiante, en ce qu'elle se détache totalement des premiers films de Kawase : le corps de la grand-mère, dans son bain, est filmé au plus près, la caméra devenant comme une main explorant les moindres replis, interstices, de ce corps vieilli, jusqu'aux seins encore amples.
Si Uno Kawase s'est longtemps, et de bon cœur, prêtée au jeu de sa fille adoptive, c'est dans ces instants d'exploration intime d'un corps que perce le désir inlassable de Kawase d'accéder à une vérité sur sa grand-mère, qu'elle ne touchait pas précédemment, par son approche frontale et ses paroles creuses. On dirait ici que, pour enfin faire sortir une quelconque vérité sur Uno, il faut passer par cette proximité confinant à une forme d'obscénité. Et de la vérité, il en sort dans le film, sous forme de reproches vindicatifs adressés à Uno, ce qui n'est pas sans susciter une gêne chez le spectateur.
Naomi Kawase en vient même à théâtraliser son approche de sa grand-mère, en cinéaste un peu rusée, lorsqu'elle s'approche avec sa caméra d'une porte au-delà de laquelle on voit Uno en train de rédiger un mot d'excuse. Le mouvement de la caméra, l'avancée progressive vers la grand-mère et le mea-culpa qui s'ensuit, garantissent le dévoilement de cette vérité tout autant qu'ils accentuent la tension dramatique.
Pour autant, "Naissance et maternité" est un film où Naomi Kawase jette son corps dans le flux des images, lorsqu'elle en vient à filmer son propre accouchement. La distance aussitôt adoptée, lorsqu'elle prend sa caméra pour filmer elle-même son fils en dit long sur son désir compulsif de cinéaste. Filmer son corps et filmer celui de sa grand-mère pourraient être envisagés comme des moments de rééquilibrage fondés sur une dialectique basique (la naissance d'un enfant, la disparition programmée d'un corps de vieille femme). Pourtant, Mitsuki, le garçon de Kawase, ne sert aucunement dans le film à maintenir le fil de cet équilibre. La grand-mère reste étonnamment au centre des interrogations de Kawase, comme une énigme irrésolue. On pourrait ainsi envisager cet accouchement comme un relais, un transfert affectif : reconstituer la mise au monde d'un enfant pour une femme qui n'en a jamais porté et qui pourtant vous a élevée.
/image%2F0998802%2F20201127%2Fob_256de4_arton5934-1450x800-c.jpg)
Avec "Chiri" (signifiant "cendres" ou "poussières", mais diffusé sur Arte sous le titre "Trace"), ultime documentaire consacrée à sa grand-mère (elle est morte en 2012, à l'âge de 97 ans), Naomi Kawase se livre à un film-somme. Les points de vue les plus contradictoires, les temporalités les plus éparses s'y entrechoquent. C'est à la fois un film qui s'attelle à l'urgence de la représentation d'un corps appelé à disparaître - et on peut faire confiance à Naomi Kawase pour capter, sur un mode qui relève du suspense, les moindres fléchissements de cette femme extrêmement âgée qui finit par ne plus la reconnaître - et une exploration nostalgique, qui donnent l'impression que l'énigme de la grand-mère adoptive n'est toujours pas percée.
D'où la volonté de recyclage d'éléments emblématiques de ses documentaires précédents : Naomi Kawase convoque à nouveau les images de son approche du corps de Uno, comme elle reprend la scène ou celle-ci lui écrit une lettre. On l'a vu au fil des documentaires, la posture n'est pas nouvelle, mais elle prend ici une signification différente : à travers le recyclage perpétuel du corps d'Uno, il s'agit de faire vivre un corps en dépassant son incapacité terminale. Posture qui relève en somme d'un mode conjuratoire de la dégradation d'un individu.
Naomi Kawase va même plus loin dans sa volonté d'ériger une sorte de totem à sa grand-mère, en transformant, par la magie du cinéma son corps en lumière. "Chiri" est ainsi un film qui fonctionne comme une cérémonie (veillée) funèbre, où les cendres d'un corps sont appelés à se muer en traces lumineuses. Le début du film est en cela emblématique, avec cette longue séquence sur une flamme qui, si elle représente symboliquement une étincelle de vie, est destinée à irriguer tout le film.
C'est ainsi que Mitsuki, le fils de Naomi Kawase, est amené à jouer un rôle prépondérant dans le film. Véritable passeur fictionnel, il lui est demandé à plusieurs reprises de faire le geste qui consiste à capturer le soleil dans sa main. L'insistance de sa mère est trop présente pour être anodine. A un moment dans le film où les propos de Kawase sur sa grand-mère se teintent d'un vrai accent nostalgique, elle en parle en disant : "Ma grand-mère sentait le soleil". Le propos devient clair : par l'opération chamanique du cinéma, et porté par le geste d'un film, le corps d'une vieille dame se réifie en astre brillant. Les limites du corps sont abolies, en même temps qu'il y a un désir utopique de le préserver par l'encerclement d'une petite main, alors qu'il devient infini.
Dans une séquence terminale, en proie à une émotion débordante qu'on ne lui connaissait pas dans ses films - elle est liée cette fois-ci à sa position devant la caméra -, Naomi Kawase explique les raisons pour lesquelles elle a été amenée à autant filmer sa grand-mère, et qui ont pour cause... son grand-père. Avant de disparaître, celui-ci lui avait demandé de le prendre en photo, ce qu'elle n'avait pas fait car elle ne pensait pas qu'il allait mourir. En déplaçant sa frustration vers sa grand-mère, elle n'a eu alors de cesse d'imprimer son image dans sa caméra, pour en capter les plus infimes variations. Révélation qui en dit long sur l'aspect compulsif du geste cinématographique de Kawase à l'endroit de cette grand-mère : lutter avant tout contre l'image porteuse de mort, inscrire sans cesse un corps dans la lumière de la nature.
Photos des films : "Katatsumori" (Escargot), "Naissance et maternité", "Chiri" (Trace)

/http%3A%2F%2Fwww.film-documentaire.fr%2Fphotos%2Farticles%2FKatatsumori1.jpg)


/http%3A%2F%2Fs1.lemde.fr%2Fimage%2F2012%2F10%2F26%2F534x267%2F1781880_3_4b06_une-scene-du-film-japonais-de-nobuhiro-suwa_2e2656f9f213eeedb67cbfa3bf2a34bd.jpg)